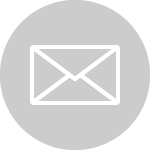En quelques jours, Fitch, Moody’s et S&P ont relevé la note du pays. Elle n’est plus qu’à un cran de celle de la France qui a été dégradée.
Pour le ministre de l’Économie, cela prouve « la confiance des marchés et des investisseurs ». On peut donc être issu d’un gouvernement de gauche et estimer qu’il faut être bien vu des marchés financiers.
Madrid poursuit ainsi sa remontée vers les notes qu’elle avait avant la terrible crise de 2008.
Il faut dire qu’entre-temps, l’Espagne a fait le boulot.
En 2007, le pays faisait partie des nations dont la dette était la mieux notée. Avec un endettement de 36 % du PIB, le pays affichait un excédent budgétaire de 1,9 %.
Un an plus tard, la bulle immobilière, qui avait porté la croissance économique espagnole, éclate. Les banques, qui avaient prêté massivement au secteur, se retrouvent insolvables, avec des actifs invendables sur les bras.
La construction s’arrête et les licenciements commencent. Le chômage passe de 8 % en 2007 à 25 % en 2012. Le déficit explose (11 % en 2009), ainsi que la dette qui dépasse bientôt 100 % du PIB.
Pour éviter de voir débarquer le FMI, le gouvernement espagnol de gauche (Zapatero), puis de droite (Rajoy), prend lui-même les mesures difficiles qui s’imposent.
Austérité brutale, baisse des salaires, augmentation de la TVA, retraite à 67 ans et réformes pour rendre le marché du travail flexible.
Les sacrifices sociaux sont considérables. La pauvreté explose et bien des gens dorment dans la rue.
Mais peu à peu, ces efforts paient.
Les déficits publics refluent. La compétitivité et les bénéfices des entreprises s’améliorent. Elles peuvent alors payer davantage d’impôts. L’industrie attire des investissements et fait repartir les exportations.
2012 : la BCE, rassurée par ce colossal effort, accorde un prêt de 100 milliards pour sauver ses banques.
2013 : le PIB cesse de reculer. Il repart à la hausse (+1,4 %) l’année d’après.
2018 : le gouvernement du socialiste Sánchez estime qu’il est temps d’alléger les souffrances de son peuple. Il engage des réformes que l’Espagne peut désormais se permettre.
Le salaire minimum est augmenté de façon spectaculaire. Les protections sociales progressent à nouveau. Les CDI reprennent l’ascendant sur les contrats précaires. La consommation repart et accélère encore le mouvement de redressement.
L’économie espagnole reste aujourd’hui une des plus compétitives d’Europe. Même assouplies, les réformes structurelles continuent à soutenir les investissements.
L’augmentation du pouvoir d’achat a été renforcée par une maîtrise des dépenses de santé. Elles sont contenues : 6,5 % du PIB contre 9,5 % en France.
Si bien que, largement financées par l’impôt, elles pèsent moins sur les salaires qu’en France (cotisations sociales = 30 % de la masse salariale en Espagne contre 48 % en France).
Le miracle économique espagnol n’en est donc pas un. Ils ont juste fait le job.